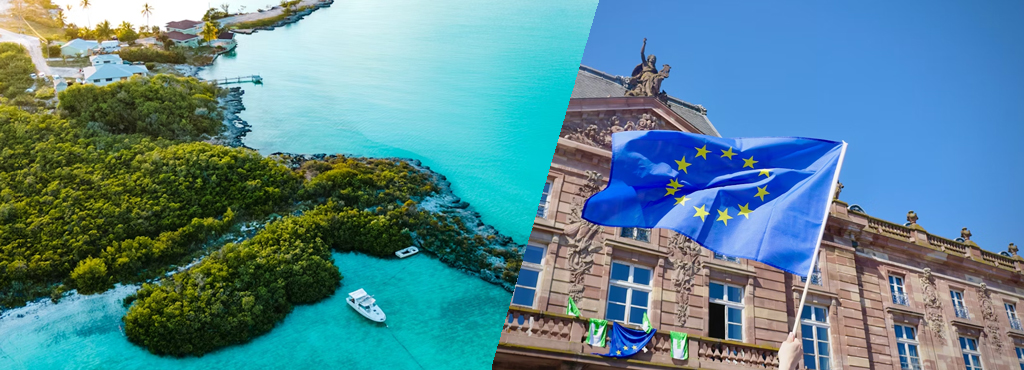
Dans un monde où la transparence fiscale progresse, une question se pose, faut-il structurer ses activités onshore, dans son pays de résidence fiscale, ou offshore, à l’étranger ? Derrière ce dilemme se joue bien plus qu’une différence de taux d’imposition. Réputation, accès bancaire, sécurité juridique, simplicité opérationnelle et coût total pèsent tout autant que la fiscalité affichée.
Ce que recouvrent vraiment les deux modèles
L’onshore renvoie à des sociétés et comptes bancaires créés dans un pays à fiscalité « classique », souvent celui où l’entrepreneur réside et paye ses impôts. L’offshore désigne une implantation à l’étranger, parfois dans une juridiction à fiscalité réduite et à réglementation plus souple. Contrairement aux idées reçues, l’offshore n’est pas illégal par nature, il le devient lorsqu’il sert à dissimuler des revenus ou à contourner les obligations déclaratives.
Depuis la généralisation des échanges automatiques d’informations (CRS/AEOI, FATCA), l’opacité s’est fortement réduite. Les conventions fiscales bilatérales, de leur côté, arbitrent quel pays peut taxer tel revenu. S’y ajoutent des clauses anti-abus : une structure sans activité réelle a de fortes chances d’être requalifiée.
Le prisme fiscal ne suffit plus
Oui, certaines juridictions offshore affichent des taux d’impôt plus bas, voir 0% pour certaines juridictions (Estonie, Lettonie, Hong Kong…). Mais l’équation ne s’arrête pas là. Les obligations de conformité, la qualité de la documentation, le coût de la comptabilité locale, l’exigence des banques en matière de connaissance client, la nécessité d’une présence effective sur place… Autant de lignes qui peuvent alourdir la facture. À l’inverse, une structure onshore supporte une fiscalité souvent plus élevée, mais bénéficie d’un cadre prévisible, de règles claires et d’une image sans ambiguïté auprès des partenaires.
Réputation et accès bancaire, les filtres décisifs
Les établissements financiers sont devenus sélectifs. Pour ouvrir un compte à une entité offshore, ils demandent parfois des pièces détaillées : description de l’activité, contrats, bénéficiaires effectifs, justification des flux, preuves de « substance » locale.
À l’inverse, une entité onshore facilite l’accès au crédit, aux subventions et à des partenaires institutionnels. Elle rassure, surtout lorsque l’activité et la clientèle sont majoritairement locales.
L’opérationnel rattrape toujours le juridique
Le choix ne se tranche pas dans un tableau, mais dans le concret : où sont les clients, où s’exécutent les prestations, où se prennent les décisions, où se trouvent les équipes, quels moyens existent sur place ? Une société offshore alignée sur un marché local (comptes bancaires dans la même devise, contrats et prestataires sur place, direction qui se réunit réellement dans la juridiction) a plus de chances de tenir la route qu’une « boîte aux lettres » déconnectée de la réalité du business.
C’est la notion de substance économique. Elle se construit avec des éléments tangibles : site internet qualitatif dans le pays où réside la société, prestataires réguliers, gouvernance documentée, contrats signés sur place, comptabilité tenue localement. Sans ces briques, le montage est fragile.
Quand l’onshore s’impose
Dès que l’activité est ancrée dans un pays — ventes, service client, entrepôts, main-d’œuvre — l’onshore apparaît comme la voie naturelle. Les appels d’offres, les levées de fonds, les partenariats avec de grands groupes y gagnent en fluidité. La sécurité juridique est supérieure, la prévisibilité réglementaire aussi. Pour beaucoup de PME, la simplicité opérationnelle vaut plus que quelques points d’impôt économisés ailleurs.
Quand l’offshore fait sens
Il reste des cas où l’offshore a une vraie logique : sociétés de services (consulting, marketing….), e-commerce et drop shipping, holdings recevant des dividendes étrangers, investissements immobiliers hors de son pays de résidence. Le fil rouge, là encore, c’est la cohérence. Une entité opérationnelle proche de sa clientèle, une holding implantée dans un pays bien doté en conventions fiscales, une société immobilière locale pour détenir un bien : ces schémas, correctement réalisés, s’inscrivent dans un cadre légal.
La méthode qui évite les mauvaises surprises
Les experts recommandent un chemin simple. Cartographier d’abord les flux réels : clients, devises, lieux de prestation, moyens de paiement, fournisseurs. Prioriser ensuite ce qui compte pour l’entreprise : réputation, simplicité, coût total, fiscalité nette. Short-lister enfin deux ou trois juridictions qui combinent conventions favorables, sécurité juridique et accès bancaire. Tester l’ouverture de compte avant la constitution, définir la substance à mettre en place, formaliser la conformité (déclarations, prix de transfert, obligations pays par pays). Ce travail amont évite les retours en arrière.
Ce qu’il faut retenir
Onshore rime avec stabilité et lisibilité. Offshore promet flexibilité et optimisation (lire l’article : découvrez les 8 raisons qui poussent les entrepreneurs à créer une société offshore), mais exige une discipline de conformité et une réalité opérationnelle sur place. Le bon choix est celui qui colle à l’activité, préserve la réputation et reste durable dans un environnement où la transparence progresse. Dans tous les cas, s’entourer de spécialistes en fiscalité internationale et en droit des sociétés, connaissant les juridictions visées, n’est plus un luxe, c’est une assurance contre l’erreur.
Article crée par Capitaleo











 SKYLAT SIA
SKYLAT SIA